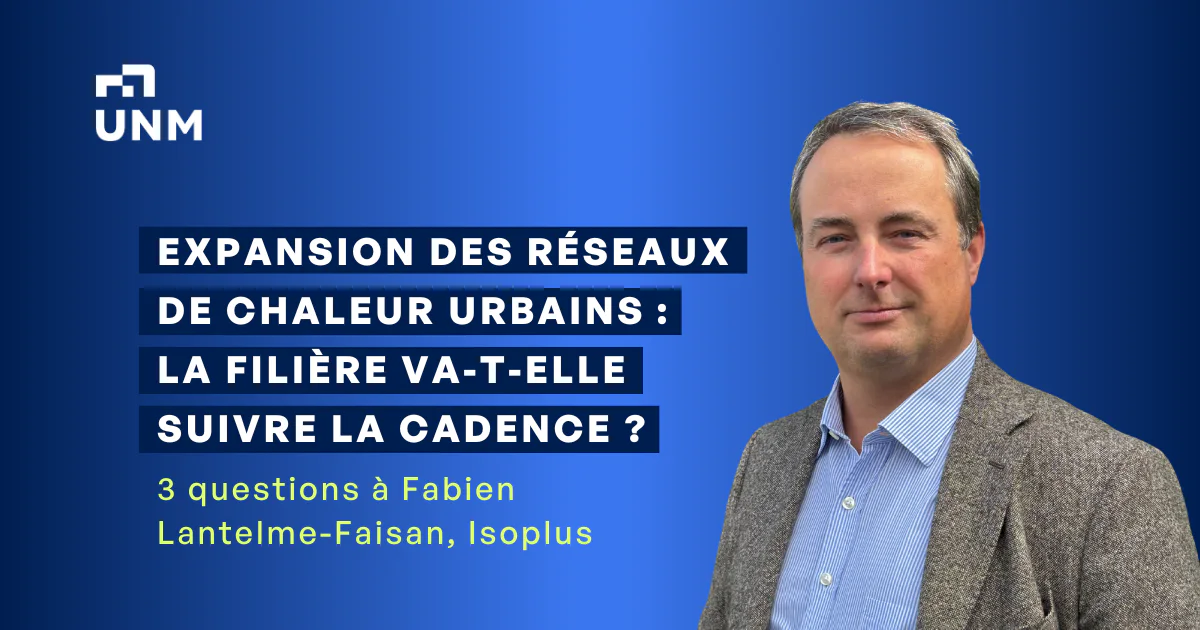Soutenu par le Fonds Chaleur à hauteur de 800M€ en 2025, le marché des réseaux de chaleur urbain est en expansion. Les professionnels du secteur s’accordent à dire qu’ils vont construire un tiers de ce qu’ils ont bâti en 30 ans… dans les cinq prochaines années. Comment avancer vite, de manière coordonnée et retenir les solutions les plus fiables, réplicables et performantes ?
Fabien Lantelme-Faisan, président de la commission de normalisation UNM 703 et Directeur Technique d’Isoplus France, fabricant de canalisations et accessoires pré-isolés, explique comment la normalisation va optimiser les pratiques du marché.
En quoi la technologie des réseaux de chaleur urbains participe-t-elle à l’effort de décarbonation ?
Aujourd’hui, les réseaux de chaleur urbains français délivrent 30 Twh d’énergie grâce à une production de chaleur issue des Energies Renouvelables ou de Récupération (EnRR) à hauteur de 66%. D’ici à 2030, nous devrions délivrer 39 TWh provenant à 75% des EnRR. Imaginez le potentiel de décarbonation au niveau européen où 50% de la consommation annuelle d’énergie sert au chauffage des bâtiments et aux sites industriels ! Les réseaux de chaleur s’inscrivent pleinement dans les technologies qui rendent atteignables les objectifs de neutralités Carbone en 2050.
Comment la filière adresse-t-elle l’enjeu de durabilité porté par la loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LTECV) ?
Le respect des prescriptions normatives et des règles de l’art de la profession permet d’atteindre une durée de vie des réseaux supérieure à 30 ans. En normalisation, pour répondre à l’exigence de durabilité, nous sommes en train de viser une durée de vie minimale de 50 ans. Ainsi, des évolutions de prescriptions sur les matériaux de base, la fabrication des canalisations pré-isolées, la manière d’étudier les réseaux et de les mettre en œuvre, mais aussi la façon de les exploiter sont en train d’être débattues entre acteurs de la filière, au sein de commissions de normalisation.
En parallèle, nous constatons aussi que la température d’exploitation des réseaux de chauffage a nettement baissé entre les réseaux de première génération et ceux actuels, passant d’un transport de vapeur à plus de 200°C au début du 20e siècle à de l’eau chaude à moins de 100°C à ce jour. Il est fort probable que cette baisse se poursuivra dans les prochaines années jusqu’à atteindre des températures voisines de 50°C. Une température d’exploitation plus basse nécessite moins de calories pour monter le réseau en température et donc une réactivité accrue dans la réponse aux besoins thermiques. Mais surtout, cela engendre moins de contraintes dans les matériaux du réseau et donc favorise leur durabilité.
Afin de répondre à ces prévisions de croissance et objectifs de décarbonation, la normalisation fait partie des réponses. Les différents acteurs du secteur doivent coordonner leurs efforts, en participant aux commissions de normalisation, afin d’accélérer le déploiement et l’installation de ces nouveaux réseaux.
Que déploient les fabricants, les installateurs et les exploitants pour aller dans cette direction ?
90% des réseaux de chauffage urbain sont exploités sous délégation de service public. Pour les exploitants tels que Dalkia, Engie, Coriance, Idex, l’enjeu est de réussir à investir dans une infrastructure ambitieuse et évolutive, tout en verdissant l’énergie et en la vendant la moins chère possible. Faire la chasse aux pertes thermiques, maîtriser et anticiper les attentes des consommateurs afin de ne produire ou de ne stocker que la stricte énergie nécessaire fait aussi parti de cette équation complexe. Le compteur Linky© du chauffage urbain n’existe pas encore mais c’est au travers d’analyses de datas précises et détaillées que les exploitants pourront relever ces défis. Les exploitants auront besoin de travailler sur des solutions interopérables et normalisées (standardisées) pour pouvoir travailler avec tous les acteurs amont et aval.
Au niveau des installateurs de réseaux de chaleur urbain, la multiplication des projets nécessite du personnel supplémentaire et qualifié. Pour plus d’employabilité et d’efficacité, les procédés de mise en œuvre doivent être similaires d’un projet à un autre. C’est exactement à cette standardisation que travaille le Comité européen de normalisation/TC 107/WG 4 en préparant de nouvelles normes sur la formation et la qualification des jointeurs et des soudeurs de PE (Polyéthylène). De plus, les installateurs déploient de plus en plus des systèmes intelligents autour des conduites (surveillance d’humidité des canalisations, capteurs divers…) qui nécessitent des formations adaptées spécifiques.
Enfin, les fabricants de canalisations pré-isolées comme Isoplus, vont accroitre leur production pour répondre aux attentes. Toutefois, aucune industrie n’a la capacité de répondre immédiatement à une croissance de 20-30% sans adapter son outil de production ou son produit. Choisir des matériaux performants et adaptés, faciliter et accélérer la production mais aussi l’assemblage des conduites sur chantier sont des leviers importants : ce sont des changements profonds et engageants au sujet desquels les fabricants doivent étudier en coordination avec les installateurs et les exploitants. C’est l’intérêt des groupes de travail au sein de la commission de normalisation UNM 703.
En résumé, qu’est-ce qui se joue actuellement pour la filière des réseaux de chaleur urbains ?
Les fabricants, les installateurs et les exploitants sont confrontés aux enjeux de durabilité et cherchent des solutions, mais pas n’importe lesquelles : des solutions validées par l’ensemble de la filière avec comme lignes directrices, une facilité de déploiement qui répond aux exigences de sécurité, de performance et de décarbonation. Nous voulons innover, chacun dans son métier, mais de manière coordonnée pour une mise sur le marché plus rapide. C’est en commission de normalisation que la filière des réseaux de chaleur urbains accordera ses pratiques, avec les marché français, européen et international. Chez Isoplus France, nous n’imaginons pas construire l’avenir de nos réseaux de chaleur nationaux sans ce dialogue à plusieurs dimensions. De plus, notre groupe étant présent dans de nombreux pays européens, nous embarquons naturellement cette vision internationale des marchés. C’est pourquoi nous avons rejoint la commission de normalisation UNM 703, qui travaille en liaison avec le CEN au niveau européen et l’ISO au niveau international. Je ne peux qu’encourager les autres acteurs Français à nous rejoindre.